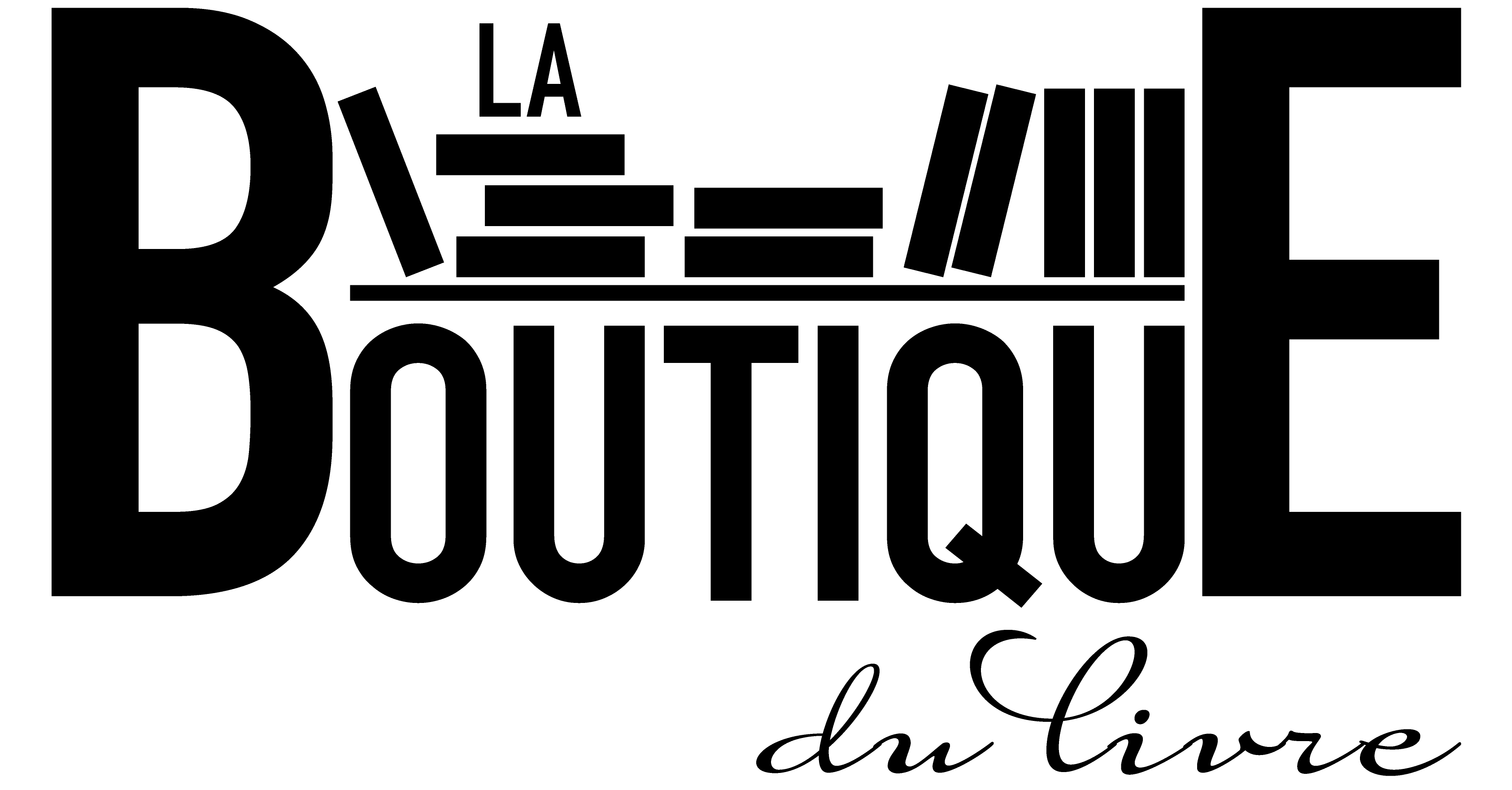« Là commence une plaine infinie
Et plus loin encore l’histoire s’arrête.
Le ciel repose lourdement sur le lac
Au fond de la chambre le bonheur moud son grain.
Butant contre les parois de pierre
L’air incendie la cour de l’été.
Il nous est donné de ne plus souffrir,
Tout se tait dans la douce laine des jours. »
Inconnus jusqu’à peu de temps, ces mots du poète Jean-Georges Lossier m’ont attendri sans prévenir dans l’anthologie « La poésie en Suisse romande depuis Blaise Cendrars », publié aux éditions Seghers. Comme la neige fondant en fins ruisseaux sur les dérupes de l’arc jurassien, à la cassure entre l’hiver et le printemps précoce, la saveur des deux strophes avait ce quelque chose de fuyant et de rassurant. Ce sentiment m’accompagnait lors d’une montée en train de Bienne à La Chaux-de-Fonds.

« Tout se tait dans la douce laine des jours. »
J’ai pris en pleine figure ce « Paysage » dont le dernier vers offre non seulement une formulation merveilleuse, mais réanime immédiatement de précieux souvenirs. Curieusement ils sont surtout enneigés alors que le poème semble dépeindre l’été (le plaisant paradoxe de la poésie), peut-être qu’ils volètent à Chaumont, au bord du lac des Taillères ou encore sur les hauteurs du Val-de-Travers. Ils m’emportent en tous les cas à une autre époque, sur un replat surplombant le plateau suisse.
Quand, revenant à peine d’une année en Amérique latine, j’ai retrouvé mon papa en me promenant dans la neige cassante quelque part entre La Tourne et Noiraigue en mars 2013. C’était un retour aux sources définitif, après les fabuleuses retrouvailles avec ma maman et ma sœur entre Mendoza et Buenos Aires en Argentine. C’est tellement loin et si proche à la fois.
« Tout se tait dans la douce laine des jours. »
Par-dessus le lac de Neuchâtel, le brouillard tissait un bitume moutonneux et doux. Les nuages avalaient toujours plus hauts les flancs du crêt parcouru. A l’horizon : les Alpes ! Chaque pas craquait dans la neige gelée. De cette escapade, je garde un sentiment de bien-être absolu. C’est là-bas que m’a renvoyé Jean-Georges Lossier.
Quand quelque chose va de travers ou que j’ai besoin d’une soupape poétique, je me souviens notamment de cette balade en raquette ou de l’Argentine en famille, pour encore et toujours me rappeler de toute « la beauté sur la terre », comme la décrit Ramuz.
« C’était sous les platanes en arrière du mur du quai, par-dessus lequel on voyait l’eau, et on voyait aussi une partie de la montagne entre le mur et les grosses branches allant à plat au-dessus de vous. Plus tard dans la saison, quand elles étaient garnies de feuilles, elles devenaient comme un plafond que le soleil, ni le regard ne traversaient, mais, en ce moment-ci, elles étaient encore à nu et tout à fait pareilles à de grosses poutres usées par l’âge et que la chaleur à la longue aurait fait gauchir, aurait tordues dans tous les sens, avec des renflements, des trous noirs, des fissures. »
Cette fragilité-là, la tendresse qui la rythme, accumulée au fil des années, et bien, elle resurgit de temps à autre dans l’entre-saison au hasard d’une lecture ou d’un lieu parcouru. Quand, au hasard d’un vers dans un train, on se souvient que plus de dix ans ont passé depuis et qu’on n’a rien oublié de la douceur d’une journée de printemps. Il reste juste un peu d’ouate mystérieuse sur les combes de la randonnée éternelle. Et le lainier Jean-Georges Lossier de lâcher son dernier fumet avec de « L’espoir ».
« La bouche pleine de fureur
Ne jette plus
Ses imprécations.
Un grand cri de joie
Fait tourner plus fort
La roue solaire.
Le monde fracturé
Recompose doucement
Son unité.
Les oiseaux se parlent
La paix revient
Comme une barque de musique »
Celle du délicat piano de « Sacred Night » de Natascha Rogers, puisant ses rythmes dans les congas, qui poursuit le voyage.